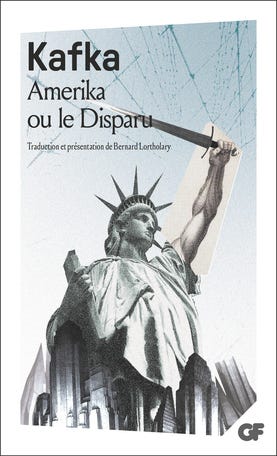Écrire New York (Kafka, Céline)
Une analyse comparée de l'arrimage à New York dans Amerika (1927) et Voyage au bout de la nuit (1932).
I. Introduction : Représenter l’Amérique
Dès le début du XIXe siècle, l’intérêt pour les États-Unis grandit : c’est le mythe américain qui se construit. Chateaubriand, en 1801 puis en 1802, publie deux courts romans, Atala et René, qui se déroulent dans une « Amérique » encore sauvage, où la cohabitation entre natifs amérindiens et colons européens est habitée par la violence et la peur. Dans ce contexte pourtant, des personnages de camps opposés parviennent à s’aimer, au-delà même de la séparation ou de la mort.
George Sand est elle aussi éprise de cette Amérique lointaine, terre de liberté à la végétation luxuriante dont elle finira pourtant par souligner les nombreux défauts : elle la désigne ainsi en 1836 de “fausse et hypocrite démocratie” — et Marie-Claude Schapira de décrire le regard de Sand sur l'Amérique comme un “‘élan d’admiration et de regret’ [constituant] le nœud douloureux de sa création romanesque1”.
Dans Mauprat, roman sandien publié en 1837, l’escapade américaine du personnage principal éponyme correspond à un épisode de liberté totale qui lui permet de mener une forme d'introspection et d'avancer dans son éducation. L'Amérique est au XIXe siècle avant tout un synonyme de liberté et de renouvellement (politique et individuel), représentée par une nature sauvage pas encore modifiée par l'homme.
Au XXe siècle cependant, le mythe américain (en réalité un mythe étasunien) change de forme : d'un imaginaire empreint de nature et de liberté, l'on passe après la Première guerre mondiale à une Amérique puissance politique, économique, sociale et culturelle. C'est le jazz, le cinéma, le développement en somme d'une culture qui inonde la France, voire toute l'Europe. Le voyage, qui plus est, de cette Europe au port de New York devenant de plus en plus facile et les récits de voyages se multipliant, l'Amérique ne peut plus être le mirage qu'elle était au XIXe siècle et devient un paysage urbain, à portée de main. On passe d'un symbole de nature libre et sauvage à une urbanité industrielle et culturelle.
Fabien Dubosson et Philippe Geinoz, dans leur réunion des actes du colloque intitulé L'Amérique au tournant. La place des États-Unis dans la littérature française (1890-1920), qualifient la période choisie de “zone d'ombre” qui “s'estompe entre un avant, qui dessine de manière un peu figée une Amérique bifrons, encore assez lointaine, et un après, qui réagit à une Amérique donnant désormais le ton”.
Dans cet avant, qui correspond aux années 1820-1880, deux traditions littéraires se mettent en place :
l’imaginaire nostalgique d'une Amérique sauvage (forêts, prairies, nature intacte) — celle qu'on trouve chez Chateaubriand et George Sand
l'Amérique industrielle / urbaine et politique (c’est le pays de la démocratie)
La “zone d’ombre” des années 1890-1920 est une période pendant laquelle s'opère un recul de l'attention portée aux États-Unis. C’est aussi le passage du pays imaginé au pays réel, matériel :
L'Amérique a pris corps. Elle a cessé d'être un écran de projection où interroger le devenir de sa propre société pour s'affirmer comme une réalité qui nous fait face, ennemi potentiel ou partenaire d'échange. Et ce qui apparaît, dès lors, quand on interroge la littérature de ces années 1890 à 1920, c'est un besoin de prendre la mesure de la réalité américaine2.
Les deux romans dont je veux parler aujourd'hui, Amerika de Kafka et Voyage au bout de la nuit de Céline, se situent dans l’après-1920, période de l’entre-deux guerres. Après la matérialisation de l'Amérique et la prise de puissance politique des États-Unis, les échanges culturels entre l'Europe et les États-Unis s'intensifient : le cinéma américain inonde les salles des pays d'Europe.
Plus largement, l'entre-deux-guerres apparaît comme le moment d'une vraie rencontre, ou d'une confrontation, avec pour enjeu le transfert possible d'une prééminence culturelle, lequel aura véritablement lieu après la Seconde Guerre mondiale3.
Cette hésitation des deux auteurs entre “recontre” et “confrontation” incarne l'ambivalence qui caractérise la représentation de l'Amérique dans l'imaginaire et la littérature européennes. Les auteurs du début du XXe s., qui vivent entourés de cette culture Outre-Atlantique, baignent dans un imaginaire de toute-puissance américaine qui résiste rarement à la confrontation réelle ou fictionnelle de l'auteur avec le pays. C'est une relation de fascination, donc précisément d'ambivalence entre attirance et répulsion, qui se dessine au XXe siècle entre l'Amérique et les auteurs qui tentent de l'écrire.
II. New York, Céline, Kafka
Pour cet article, je me concentrerai sur New York, lieu d’arrivée de l’Europe aux États-Unis qui marque la sortie du mythe et l’entrée dans le Nouveau Monde, dans les limites et les décalages que cela implique.
Je m’arrêterai notamment sur deux personnages romanesques de la littérature européenne du début du siècle, afin de confronter et de lier deux perceptions de l’arrivée en terre américaine : le premier, Bardamu, est le personnage principal du Voyage au bout de la nuit de Céline ; le second, Karl Rossmann, du roman inachevé Amerika ou Le Disparu de Kafka.
Les arrimages de Karl et de Bardamu s'inscrivent tous deux dans un voyage initiatique. C’est le troisième pour Bardamu qui revient d'Afrique, le premier pour Karl qui quitte le foyer familial viennois et part en Amérique sur les traces de son oncle. Dans les deux cas, le continent américain, et New York en particulier, n'offrira pas aux deux personnages le Nouveau Monde imaginé et rêvé : dès l'arrivée au port de New York, la déception de Bardamu et la déstabilisation de Karl se mettent en marche, et disent d'ores et déjà l'échec romanesque de cette rencontre avec une ville rutilante de pauvreté, violente dans son rejet de l'Autre qui tend, surtout chez Kafka, à l'absurde.
Commençons donc par contextualiser ces arrimages, qui avant d'être fictionnels, sont matérialisés dans la publication même de ces romans : ainsi Amerika, en 1927, puis Voyage au bout de la nuit en 1932, emmènent le lecteur français ou germanophone dans le Nouveau Monde qui constitue toujours pour lui un lieu mythique, voire utopique.
C'est dans les années 1910 que “la modernité américaine [...] entame vraiment le processus de sa propre mise en scène ‘spectaculaire’4”. Au début du XXe siècle, les auteurs confrontés à la modernité américaine se voient dans l'obligation d'abandonner l'imaginaire utopique fondé au début du siècle précédent. Ainsi Blaise Cendrars raconte dans ses Écrits de jeunesse son séjour à New York :
Dans la rue, quand, assommé par le bruit, écrasé par les gratte-ciel, on n'en peut plus, — tout à coup, une réminiscence de lecture vous foudroie le cerveau. Chateaubriand, les Indiens, Paul et Virginie, l'Amérique et la beauté de sa nature, les tropiques qui doivent être là, derrière ces murs et ces fumées, et les horizons ensoleillés que le voyage vous a mis dans le cœur, fusent, en douloureuses nostalgies : partir !
Cette déception c'est, selon Dubosson et Geinoz, celle d'une “imposture” :
“l'Amérique n'est pas là où elle devrait être”
En réalité, les États-Unis sont bien là, mais le mythe américain ne l'est pas : ce sera le constat de Bardamu, et c'est cette contradiction latente qui sera une des causes de la désorientation de Karl.
Les romans de Céline et de Kafka arrivent après le déploiement, au tournant du siècle, des récits de voyages dans lesquels l'arrivée dans le port de New York constitue un moment topique et véritablement symbolique, constitué de nombreux lieux communs : c'est la description du pont de Brooklyn, de la Statue de la Liberté ou encore du fleuve de l'Hudson. Surtout, c'est le passage à une autre temporalité : Dubosson et Geinoz soulignent ainsi le passage d'un voyage spatial, rendu banal au fur et à mesure qu'il se simplifie, à un voyage temporel :
il s'agit, en traversant l'océan, d'aborder le futur lui-même, en commençant par New York, la ‘capitale du modernisme’5
Kafka et Céline vont alors jouer avec ces codes littéraires et picturaux, donnant à voir certains éléments plutôt que d'autres, dissimulant ou transformant les topoï qui semblaient incarner l'essence américaine. Chez les deux auteurs, la déformation d'une ville qui ne correspond pas à son mythe se matérialise dans la déformation physique de son architecture et de sa géographie : ainsi Kafka remplace le flambeau porté par la statue de la Liberté par un glaive ; Céline quant à lui fait des gratte-ciels new-yorkais une véritable “muraille” s'élevant sous une pluie crasse, et établit sous le Manhattan doré des cabinets souterrains.
(Si cet article ne s’affiche pas en entier, vous pouvez le lire en ligne.)
III. Franz Kafka, Amerika ou Le Disparu (1927)
Amerika est publié à titre posthume, 3 ans seulement après la mort de l'auteur. Premier roman de Kafka, il a été écrit entre 1911 et 1914 et est resté, comme ses deux autres romans, inachevé.
Chez Kafka, l’Amérique est d'abord un souvenir national et familial :
National, parce que l'émigration religieuse au XVIIe s. puis politique au XIXe s. des Allemands à Philadelphie et plus largement aux États-Unis conduit à la représentation d'une Amérique terre d'espoir et de richesse qui perdure encore au début du XXe s., lorsque Kafka écrit Amerika.
Familial, parce que si Kafka n'est jamais allé aux États-Unis, l'Amérique correspond cependant à ce Nouveau Monde où ont émigré certains de ses oncles et cousins : en 1909, son cousin Franz débarque à New York et entre dans un internat proche de la ville ; en 1911, son autre cousin, Otto, fait fortune à New York en fondant une entreprise, et ce après avoir commencé au bas de l'échelle sociale (il est d'abord portier, comme Karl Rossman dans le roman).
La raison pour laquelle Karl, le personnage principal d'Amerika, est envoyé par sa famille aux États-Unis, réside dans sa liaison avec la bonne de sa maison, dont il a engendré la grossesse. Ses parents l'envoient chez son oncle afin que ce dernier l'éduque et lui assure un avenir professionnel. Cependant, ce qui se présente comme un Bildungsroman6 va rapidement prendre la forme d'une dégringolade sociale et individuelle : non seulement Karl ne parvient pas à réussir financièrement aux États-Unis, mais il peine aussi à trouver sa place et ses marques dans une société délirante, à la rapidité fulgurante et aux relations humaines résolument absurdes. D'une certaine manière, la “fausse arrivée” de Karl à New York — sur laquelle l'on reviendra dans un instant — annonce le développement régressif, à contre-sens, que va prendre l'intrigue du roman.
C’est donc sur cet incipit que l'on va s'arrêter aujourd'hui :
Lorsque Karl Rossmann, jeune homme de dix-sept ans qui avait été envoyé par ses pauvres parents en Amérique, parce qu’une bonne l’avait séduit et avait eu un enfant de lui, entra dans le port de New York sur le bateau à l’allure déjà plus lente, il s’aperçut que la statue de la déesse de la Liberté qu’il observait depuis longtemps déjà, était baignée par des rayons de soleil soudain plus forts. Le bras qui brandissait l’épée semblait s’être dressée à l’instant, et autour de son grand corps soufflaient les vents libres.
“Si grande que ça”, se dit-il et, comme il ne songeait plus du tout à partir, il fut peu à peu repoussé contre le bastingage par la foule sans cesse grossissante des porteurs qui passaient près de lui.7
À son arrivée à New York, Karl est un adolescent : l'entrée dans le roman fonctionne comme une entrée dans la vie adulte, puisqu'il vient a priori de perdre sa virginité, ou en tout cas son innocence d'enfant en devenant père. Cette entrée est donc triple, puisque Karl débarque en même temps dans la vie adulte, dans le roman et dans le port de New York. Contrairement à Bardamu, qui arrime après déjà 200 pages de roman, Karl y arrive avec une profonde inexpérience de la vie : l'aventure new-yorkaise s'inscrit ici dans la forme du roman d'apprentissage, forme dans laquelle un personnage inexpérimenté et placé au bas de l'échelle sociale va parvenir à s'élever moralement et socialement en traversant diverses aventures. Mais ce schéma est inversé dès la première phrase du roman : Karl vient d'une famille à même de s'offrir les services d'une bonne mais finira par être renvoyé de son travail en tant que portier puis par passer des auditions pour faire partie d'une troupe de théâtre. La chute sociale de Karl Rossmann sera d'autant plus radicale qu'il avoue, à la fin du roman, son ambition initiale : “Je voulais devenir ingénieur.”
Cette chute est le produit d'une double faute : Karl est expédié en Amérique parce qu'il a commis une faute sexuelle (la liaison avec la bonne) et une faute sociale, la bonne étant inférieure à lui en termes de classe. Dans cette genèse romanesque aux relants bibliques, la bonne, comme Ève, a séduit Karl, et cette séduction, plutôt que de montrer la perversité de la femme, donne à voir la passivité extrême de Karl, qui le caractérisera tout au long du roman. Et, déjà, Karl se laisse expédier par ses parents, quittant le lieu pur et innocent de l'enfance pour un “nouveau monde” où le bien se doit de côtoyer le mal.
Ce que Karl voit en premier en arrivant au port de New York, c'est la statue de la Liberté qui est “baignée par des rayons de soleil soudain plus forts”. Cette lumière, qui fait de la statue une apparition sacrée, remplace le flambeau qu'elle ne porte pas et qui est d'autant plus visible dans son absence que la lumière du soleil s'y substitue. Ce qui est illuminé, ce n'est pas la statue comme symbole de liberté, mais ce “bras armé d'un glaive” qui annonce la violence sous-jacente du rêve américain. La statue de la Liberté s'impose dans le texte comme une immobilité et une résistance implacables, c’est-à-dire comme le contraire absolu de Karl qui lui se laisse porter, littéralement et figurativement, par les vagues : c'est ce qui se passe lorsque “la foule sans cesse grossissante des porteurs” le pousse contre le bastingage, comme si Karl ne pouvait avancer sans être porté ou poussé. Cette rencontre, c’est la rencontre, en quelque sorte, d’un David impotent ou impuissant et d’un Goliath dont Karl souligne d’emblée la hauteur : “‘Si grande que ça’, se dit-il”. Or, la rencontre avec l'Amérique sera bien une confrontation, où la faiblesse et la passivité de Karl ne pourront que causer sa perte, face à cette statue qui dit l'ambivalence essentielle des États-Unis, entre toute-puissance illuminatrice et agression revendiquée.
Dans l'observation de Karl depuis le pont du bateau, difficile qui plus est de ne pas voir une proximité avec l'image, très littéraire, du balcon, cet espace intermédiaire qui constitue un entre-deux entre l'intérieur (ici le bateau, dernier vestige de l'ancien monde quitté) et l'extérieur (le Nouveau Monde). Comme sur le balcon, le sujet qui regarde est aussi l'objet d'une observation extérieure : la scène d’apparition de la statue est aussi la scène dans laquelle Karl apparaît pour la première fois devant les américains, qui s'étonnent déjà de son peu d'enthousiasme.
L’incipit se poursuit ainsi :
Un jeune homme avec lequel, pendant la traversée, il avait vaguement lié connaissance dit en passant : “Alors, vous n’avez donc encore aucune envie de débarquer ? — Mais je suis prêt”, lui dit Karl en riant et, comme c’était un solide garçon, il chargea crânement sa valise sur son épaule. Mais comme il regardait son compagnon qui, balançant légèrement sa canne, s’éloignait déjà avec les autres, il s’aperçut avec consternation qu’il avait oublié son propre parapluie dans la soute du bateau. Il demanda rapidement à son compagnon qui n’en parut pas très heureux, d’avoir l’amabilité d’attendre un instant près de sa valise, examina rapidement les lieux pour s’y retrouver à son retour et partit d’un pas pressé. En bas, il trouva à son grand regret, barré pour la première fois, le couloir qui aurait beaucoup raccourci son chemin, ce qui avait probablement rapport avec le débarquement de tous les passagers, et il dut péniblement chercher son chemin à travers une infinité de petites salles, de coursives qui changeaient sans cesse de direction, de courts escaliers qui n’arrêtaient pas de se succéder, une pièce vide avec un bureau abandonné, jusqu’à ce que, effectivement, n’ayant parcouru ce chemin qu’une ou deux fois et toujours en assez nombreuse compagnie, il se trouvât bel et bien perdu.
L’arrimage de Karl au début du roman est en réalité un “faux départ” : alors même qu’il tente, presque par défi, de prouver sa détermination à débarquer, il se rend compte que son parapluie (objet très banal et pas des plus essentiels, disons-le) est resté dans le bateau. S’ensuit alors un périple de Karl dans l’antre du navire, qui retarde l'arrivée à New York d’une trentaine de pages. Et le second (vrai) arrimage, lui, est ellidé : la rencontre avec le nouveau monde a déjà été faite, sa violence et son absurde déjà annoncées. C’est ce périple à l'intérieur du bateau que Jacques Dugast qualifie de “passage dans une sorte de sas, une transition vers cet autre monde qui sera pour lui le Nouveau Monde8.” Il ajoute :
La Ville [...] est le lieu d'une mise en procès, l'espace d'un questionnement harcelant sur l'identité.
L'expédition de Karl aux États-Unis, a priori destinée à faire son éducation, est en réalité une forme de châtiment pour la faute dont il s'est rendu coupable :
Exilé, expulsé, humilié, Rossmann est bien le frère de Grégoire Samsa et de Joseph K. Comme eux il est condamné à souffrir avant de disparaître. La Ville est l'instrument de son supplice.
L’arrivée à New York prend la forme d’une arrivée au purgatoire ou en enfer, à l’opposé de l’utopie ou du paradis viennois. Dans cette lecture, le faux départ et le retour à l'intérieur du bateau fonctionnent comme une tentative d'éviter à la fois la punition et la responsabilité d’une faute qui remet en question toute son identité. Karl, précisément, n’est plus un adolescent viennois, il est un jeune adulte dont la mission consiste à présent à trouver sa place dans un monde étranger et violent. Le roman d’apprentissage est renversé parce qu’au lieu de trouver son identité, Karl la perd : d’où ce titre, Der Verschollene, Le Disparu. L’Amérique est le lieu où le personnage, l’être individuel disparaît ; Vienne est, comme le jardin d’Eden, le lieu où l’on ne revient jamais.
Claudine Raboin voit elle-même dans ce refus de débarquer une forme de contradiction qui prend racine dans la culpabilité du protagoniste :
Dans le premier chapitre, une sexualité inassumée rend le héros devenu père malgré lui coupable d’avoir été séduit, de sorte qu’il se trouve contradictoirement expulsé du paradis de ses origines et envoyé en exil en Amérique, figure mythique du paradis terrestre. En conséquence [...], le héros arrivé dans le port de New York tourne le dos à l’Amérique en se réfugiant dans les bras du premier venu (le soutier du navire), qui le remet finalement à son oncle, sévère substitut paternel9.
Mais Amerika ou le Disparu est aussi le premier roman de Kafka : et pour Claudine Raboin toujours, le débarquement aux États-Unis peut se lire comme un débarquement personnel dans une matière nouvelle, celle du roman. Comme Karl, Kafka débarque dans un monde dont il doit assimiler et s’approprier les codes ; et si l’on ne peut pas dire de l’écriture de Kafka qu’elle est un échec, on ne peut ignorer le fait que ses trois romans, Amerika, Le Procès et Le Château, sont tous restés inachevés, les paradoxes essentiels et l'absurde radical présents dans ces trois romans ne pouvant être résolus que par une fuite, fuite matérielle ou psychologique du personnage incapable d'agir dans un monde qui le pousse et le repousse.
On le sait, Kafka avait une relation conflictuelle, névrotique presque avec l'écriture sans laquelle il ne pouvait et ne voulait pas vivre : il était hanté par la question de l'échec, du recommencement et de l'inachèvement, des thèmes que l'on retrouve dans bon nombre de ses écrits. Si Amerika ou le Disparu est l'entrée de l'auteur dans la forme romanesque, il est aussi l’entrée dans une nouvelle confrontation à l’échec : pourtant Kafka a écrit, et son nom n’a pas disparu.
IV. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932)
Voyage au bout de la nuit est, lui aussi, le premier roman de Louis-Ferdinand Céline. Pendant 500 pages, il suit le parcours de Ferdinand Bardamu, protagoniste et narrateur d'une histoire qui s'étend de la première guerre mondiale aux années 1930, en passant par le colonialisme et le fordisme. Après avoir démythifié l'imaginaire colonial dans l'épisode africain du roman, Céline s’attache à faire s’effondrer le mythe américain : atteint d’une maladie dite “tropicale”, Bardamu est embarqué sur une galère en direction des États-Unis, où il va découvrir une ville sale, grotesque et, encore une fois, aux confins de l'absurde.
L'Amérique que connaît Céline est néanmoins bien moins chimérique que celle de Kafka, puisqu’il se rend à Détroit dans les années 1920 en compagnie d’autres médecins.
Dans l’épisode américain du roman, Bardamu visite New York puis Detroit, où il est employé comme ouvrier chez Ford — Céline lui-même avait par ailleurs visité les usines Ford pendant son voyage aux États-Unis. C’est le dernier voyage de Bardamu avant son retour en France et son établissement en tant que médecin des pauvres.
Claire Perrin voit dans Le Voyage au bout de la nuit “une critique sociale qui passe par la satire, le grotesque et le délire10”. Comme dans Amerika, l’arrivée en Amérique signe chez Céline le début d'une aventure absurde et délirante qui renverse l'image d'une Amérique porteuse d’un espoir de richesse et de renouveau. Selon elle, Céline
…questionne la forme du récit de voyage, ce “vertige pour couillons” selon Bardamu à l'heure où presque plus aucune parcelle de terre ne reste à explorer [...]. La rencontre de l'altérité propre au récit de voyage est toujours synonyme de relativisation et porte en elle le miroir tendu au voyageur11
Là où Kafka, en renversant le mythe américain, renversait aussi le Bildungsroman, Céline quant à lui renverse la forme du récit de voyage en mettant son narrateur face à un paysage urbain carnavalesque et déformé, et en donnant pour seul constante à ce “voyage” (au singulier dans le titre) l’identité d’un narrateur et personnage misanthrope et pessimiste, qui erre plus qu’il ne voyage réellement. Là où les récits de voyage racontent habituellement les découvertes et la beauté des paysages étrangers, Bardamu dit la laideur et la misère des tranchées, des colonies puis des États-Unis.
L’épisode américain, dans Le Voyage au bout de la nuit, n’est pas le débarquement narratif que l’on trouvait chez Kafka ; c’est le troisième et dernier voyage de Bardamu avant son retour en France ; c’est en quelque sorte le troisième cercle de l'Enfer célinien, dont on pourrait esquisser une brève typologie : les tranchées seraient celui de la violence, les colonies correspondraient aux Limbes et les États-Unis seraient le cercle de la gourmandise (au sens large, à la fois monétaire et rabelaisien), qui chez Dante, dans le fameux Inferno, punit les pécheurs en les immergeant dans la boue :
Je suis au troisième cercle de la pluie éternelle, maudite, froide, pesante : toujours la même, toujours elle tombe également. Des averses de forte grêle, et d’eau noire, et de neige, traversent l’air ténébreux ; fétide est la terre qui les reçoit. Cerbère, bête cruelle et de forme monstrueuse, avec trois gueules aboie contre ceux qui sont là submergés. Il a les yeux rouges, la barbe grasse et noire, le ventre large, les mains armées de griffes : il déchire les esprits, les écorche, et les dépèce. La pluie les fait hurler comme des chiens : fréquemment les malheureux profanes se tournent faisant d’un de leurs côtés un abri à l’autre12.
Or, la pluie est un élément fondamental dans l'arrimage de Bardamu à New York ; elle est, entre autres, ce qui fait patauger les voyageurs et immigrants dans la boue, et ce passage de l'eau à la boue se retrouvera ensuite dans la description des cabinets souterrains.
Le chapitre 14 du roman se termine ainsi :
L’Infanta Combitta roula encore pendant des semaines et des semaines à travers les houles atlantiques de mal de mer en accès et puis un beau soir tout s’est calmé autour de nous. Je n’avais plus de délire. Nous mijotions autour de l’ancre. Le lendemain au réveil, nous comprîmes en ouvrant les hublots que nous venions d’arriver à destination. C’était un sacré spectacle !
L’arrivée aux États-Unis coïncide avec la fin du délire de Bardamu, qui n'est donc plus en proie aux divers symptômes de sa maladie : c'est un moment, ainsi, où il est renvoyé à une réalité crue et inaltérée par les fantaisies de son esprit. Or, le réveil sera brutal : contre le mythe américain, la liberté et le progrès, Bardamu s'apprête à découvrir un “spectacle”, un carnaval grotesque et sale qui n'a rien à voir, précisément, avec le fantasme américain.
C’est ainsi, alors, que s'ouvre le chapitre 15 et, avec lui, l'aventure de Bardamu en Amérique :
Pour une surpise, c’en fut une. À travers la brume, c’était tellement étonnant ce qu’on découvrait soudain que nous nous refusâmes d’abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu’on était on s’est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit devant nous…
Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux même. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur.
On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on n’en pouvait rigoler nous, du spectacle qu’à partir du cou, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là à travers une grosse brume grise et rose, et rapide et piquante à l’assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s’engouffraient aussi à la charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetées, là où venait finir une eau caca, toute barbotante d’une kyrielle de petits bachots et remorqueurs avides et cornards.
La première rencontre de Bardamu et de ses coéquipiers avec la ville de New York se fait par la vue, une vue “à travers la brume” d'abord, puis qui laisse apercevoir bientôt une ville droite et haute. Sans surprise, tout le passage est à lire avec une représentation phallique de la ville américaine qui s'oppose à la passivité et à la soumission des villes (et des femmes) françaises. L’Amérique, terre de liberté, abriterait a priori des femmes tout aussi libres, donc indépendantes, droites, insoumises. Or,
[avec] la sexualisation immédiate de la ville “pas baisante du tout” [...] apparaît paradoxalement le signe avant-coureur de la déception à venir, dans l'impossibilité pour Bardamu de trouver à New York le moyen d'assouvir son désir.13
Mais la hauteur de la ville, hors de l'imaginaire sexuel et phallocentré de Bardamu, est aussi littérale : c'est ce “Si grande que ça” de Karl Rossmann qui se fait entendre dans l'étonnement des galériens. Un étonnement et une surprise qui deviennent un rire : “Ça fait drôle forcément, une ville bâtie en raideur” ; un rire limité, voire empêché par le froid qui, après la surprise, frappe le corps, comme un retour à cette réalité physique violente qu’ils s'apprêtent à découvrir. C’est ce que Dubosson et Geinoz ont appelé “le choc et la sidération hilare de Bardamu et de ses camarades galériens14”, disant ainsi déjà l'immobilité, c'est-à-dire une forme d'impuissance, des galériens face à la ville brutale et masculine — plus loin, elle leur “giclera” dessus, avec toutes les connotations que ce verbe porte.
Quant à cette ville debout, jaillissant des brumes, elle devient une “muraille” entourée d'une “eau caca” — et on notera la délicatesse légendaire de l'écriture célinienne, qui s’inscrit dans le carnavalesque et l’humour scatologique d’un Rabelais. Le carnavalesque qui, comme le rappelle Claire Perrin, est dans le rire, le sexuel (avec “le pouvoir revivifiant de la partie basse de l'anatomie”) et le grotesque.
La chapitre continue ainsi :
Pour un miteux, il n’est jamais bien commode de débarquer nulle part mais pour un galérien c’est encore bien pire, surtout que les gens d’Amérique n’aiment pas du tout les galériens qui viennent d’Europe. “C’est tous des anarchistes” qu’ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux en somme que les curieux qui leur apportent du pognon, parce que tous les argents d’Europe, c’est des fils à Dollar.
J’aurais peut-être pu essayer comme d’autres l’avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage et puis une fois au quai de me mettre à crier : “Vive Dollar ! vivle Dollar !” C’est un truc. Y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui après ça ont fait des fortunes. C’est pas sûr, ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Moi, j’avais une autre combinaison en tête en même temps que la fièvre.
À bord de la galère ayant appris à bien compter les puces (pas seulement à les attraper, mais à en faire des additions, et des soustractions, en somme des statistiques), métier délicat qui n’a l’air de rien, mais qui constitue bel et bien une technique, je voulais m’en servir. Les Américains on peut dire ce qu’on voudra, mais en fait de technique, c’est des connaisseurs. Ils aimeraient ma manière de compter les puces jusqu’à la folie, j’en était certain d’avance. Ça ne devait pas rater selon moi.
J’allais leur offrir mes services quand tout d’un coup on donna l’ordre à notre galère d’aller passer une quarantaine dans une anse d’à côté, à l’abri, à portée de voix d’un petit village réservé, au fond d’une baie tranquille, à deux milles à l’est de New York.
Le rejet, plus graduel et sous-jacent chez Kafka, est ici immédiat : les galériens européens sont pour l'Amérique comme ces puces que Bardamu se fait un devoir de compter, des parasites symptômes d'une maladie et d'une pauvreté qui les dépassent. Face à ce rejet, la réaction de Bardamu est encore et toujours cynique et provocatrice : il s'imagine arrivant à la nage en criant “Vive Dollar !”, soulignant avec ironie, déjà, l'idolâtrie étasunienne pour ce “nouveau Dieu” qui semble régir toute la société américaine. Comme l'écrit Claire Perrin, Bardamu utilise “l'ironie et l'humour comme miroir grossissant et déformant pour ridiculiser l'Amérique” : en se dépeignant ainsi nageant et criant à la gloire du sacré-saint Dollar, et en en faisant une cause possible de réussite professionnelle, Bardamu tourne en ridicule l'obsession des États-Unis pour un progrès exclusivement économique. De la même manière, sa rationnalisation du comptage de puces à coups de statistiques et de comptabilité dit la vacuité de cet amour des États-Unis pour les “statistiques” : statistiques de quoi, de qui, qu'importe, tant que le chiffre règne. Alors, on compte : l'argent, les puces, les migrants.
Quant à la quarantaine imposée aux galériens, elle est primordiale en ce qu'elle renchérit à la fois sur le renvoi du migrant au statut de parasite, sur le rejet de l'étranger en général et sur l'importance extrême apportée au corporel. C’est parce que les corps arrivant dans la galère sont soupçonnés d'être malades ou même simplement sales qu'ils sont rangés de côté pour un temps.
Là où Karl voyait son arrimage délayé par la peur d’entrer en terre nouvelle, Bardamu et ses compagnons voient le leur délayé aussi, mais par initiative de la ville elle-même : ainsi ils ne sont jamais accueillis, mais tout au plus tolérés. L’hostilité plutôt existentielle chez Kafka se fait ici hostilité physique, et l'on aperçoit déjà dans cette ville qui brandit un glaive invisible l'esquisse d'une New York castratrice qui donne richesse et liberté à un petit nombre en dérobant celles du plus grand nombre. Le fossé, déjà, est creusé entre l'Amérique mythique et les galériens appartenant aux bas-fonds newyorkais ; et ce fossé était d'emblée présent dans le contraste entre la ville a priori futuriste et la galère, navire proprement anachronique pour le XXe siècle.
En sautant quelques paragraphes qui concernent les évènements survenus pendant la quarantaine, on arrive à la fin du chapitre 15, l'arrimage — le vrai — dans la ville de New York :
Dès que nous touchâmes au quai, la pluie en trombe se mit à nous gicler dessus et puis à travers mon mince veston et sur mes statistiques aussi qui me fondirent progressivement dans la main. J’en gardai cependant quelques-unes en tampon bien épais dépassant de ma poche, pour avoir tant bien que mal l’air d’un homme d’affaires dans la Cité et je me précipitai rempli de crainte et d’émotion vers d’autres aventures.
En levant le nez vers toute cette muraille, j’éprouvai une espèce de vertige à l’envers, à cause des fenêtres trop nombreuses vraiment et si pareilles partout que c’en était écœurant.
Précairement vêtu je me hâtai, transi, vers la fente la plus sombre qu’on puisse repérer dans cette façade géante, espérant que les passants ne me verraient qu’à peine au milieu d’eux. Honte superflue. Je n’avais rien à craindre. Dans la rue que j’avais choisie, vraiment la plus mince de toutes, pas plus épaisse qu’un gros ruisseau de chez nous, et bien crasseuse au fond, bien humide, remplie de ténèbres, il en cheminait déjà tellement d’autres de gens, des petits et des gros, qu’ils m’emmenèrent avec eux comme une ombre. Ils remontaient comme moi dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C’était les pauvres de partout.
C’est dans cette fin de chapitre que tout, de l'arrivée à New York, se dit.
La pluie, d'abord, porte avec elle une multitude de sens : mouvement vers le bas, elle s'oppose à la ville droite qui s'élève vers le ciel du “Dieu Dollar”, elle s'abat sur les intrus et incarne le renversement qui prend place dans le passage. Elle peut aussi être lue dans un parallèle avec le chant VI de l’Enfer de Dante, faisant de la ville une forme d'enfer sur terre et de Bardamu un “visiteur des enfers” qui, comme le narrateur de Dante, finit par rentrer chez lui. Enfin, la pluie participe de l'imaginaire sexuel de tout le chapitre : elle “gicle” sur Bardamu et ses camarades, ce après quoi Bardamu se hâte “vers la fente la plus sombre qu'on puisse repérer” (pas besoin d'expliquer je pense, donc passons). La ville apparaît comme une femme castratrice, dont la puissance d'action et la noirceur s’opposent à la passivité des galériens — on se retrouve encore une fois dans un schéma analogue à celui qui opposait Karl et la ville de New York. On pourra d'ailleurs remarquer que chez Céline, la ville, bien qu’elle ne soit “pas baisante du tout”, porte les marqueurs du plaisir sexuel — l'érection des bâtiments, l'éjaculation de la pluie — renvoyant ainsi Bardamu à sa malchance amoureuse et plus généralement à l'absence de femmes dans sa vie comme dans cet instant précis, puisqu'il sort à peine d'un long voyage en compagnie exclusivement masculine.
New York se fait aussi ville carcérale (ce qui va de pair avec l'image de la femme castratrice, puisqu'elle prive l'homme de sa masculinité et/ou de sa liberté) : l'horizon newyorkais devient dans les termes de Bardamu une “muraille” qui a déjà enfermé les galériens pendant leur quarantaine, et qui les enferme encore alors qu'ils se pensent en liberté. Dans ce terme seul de “muraille”, Céline dit l'illusion de cette prétendue liberté américaine qui n'en est pas une — l'on remarquera d'ailleurs qu'il n'a toujours pas été fait mention de la statue de la Liberté. Dans cette ville carcérale où soit tout le monde, soit personne n'est libre, Bardamu redevient bien vite une puce parmi les puces, et c'est la pauvreté omniprésente qui vient clore le chapitre.
Enfin, le centre névralgique de l'arrimage à New York réside dans l'expression “vertige à l'envers”, qui donne à voir le carnavalesque du texte célinien. Le carnaval, dans ses origines antiques, correspond en effet à une situation d'inversement : pendant une journée, les esclaves deviennent maîtres et les maîtres se font esclaves, tout en sachant bien entendu qu'ils auront de quoi se venger le lendemain, et tous les jours d'après. Ici c'est la ville qui est renversée : la pluie tombe à contre-sens de l'élévation des bâtiments, et puis l'on a ces hommes dans la rue qui marchent “le nez en bas”. Prise figurativement, cette formule dit un refus ou une difficulté à regarder la ville ou les gens dans les yeux ; elle dit aussi l'attention nécessaire pour éviter la chute sur le pavé mouillé. Mais prise dans un sens littéral, le nez placé en bas indique un renversement du corps, le bas du corps se trouvant en haut, comme glorifié, et le haut rejeté en bas. Tout, dans cette ville, est “sens dessus dessous”, les gens ont la tête en bas, comme si l'on se trouvait de l'autre côté du globe. New York, la vraie, n'est finalement que l'envers absurde et cauchemardesque de son mythe, qui n'est rien de plus que cela : un mythe.
C’est ce même processus d'inversement que l’on trouvera plus tard dans le texte, comme le fait remarquer Claire Perrin :
V. Conclusion
Avant de clore cet article, revenons sur quelques points de convergences de ces deux textes qui n'ont, évidemment, pas été réunis par hasard :
Sans surprise, ils s'inscrivent tous deux dans une entreprise de démystification du mythe américain, Kafka en en faisant un lieu absurde, presque cauchemardesque, et Céline en le renversant complètement. L’on pense à ce passage, à la fin d'Amerika ou le Disparu :
Ainsi, vous êtes libres ? — Oui, je suis libre, fit Karl, et rien ne lui paraissait plus dénué de valeur que sa liberté.
Les deux romans, qui plus est, se construisent autour d'un protagoniste caractérisé par une forme de passivité : aucun n'a pris la décision de partir (Karl est envoyé à New York par ses parents, Bardamu y est transporté alors qu'il est malade et quasiment inconscient) et tous deux se retrouvent face à une ville immense et forte de violence qui les renvoie irrémédiablement à leur propre impuissance.
Elle se fait aussi, d'une certaine manière, enfer ou purgatoire : enfer pour Bardamu qui ne trouve satisfaction dans aucun de ses voyages puisque tous lui donnent à voir la violence et la laideur des hommes ; purgatoire pour Karl qui a à purger sa faute — mais peut-être aussi est-il déjà en enfer...
On retrouve dans les deux passages, aussi, un délai avant l'arrimage, qui dit la peur ou le rejet, une difficulté de la rencontre qui demande un temps, une pause narrative de l'un ou l'autre côté. L’autre, toujours, représente un danger : l'Amérique inconnue est un danger pour le jeune Karl, encore intouché par la cruauté de l'absurde ; les galériens sont un danger biologique, corporel pour l'Amérique qui se veut propre et immaculée, alors même qu'elle cache sur son sol, là où personne ne pense à regarder, justement parce que la ville est si haute, elle cache sur son sol des ordures, des excréments, en bref une pauvreté crasse qui contient en elle l'échec radical du progrès et du mythe américains.
Enfin, un dernier détail fait se rejoindre les deux textes, dans une similarité étonnante pour des auteurs radicalement différents : si Karl finit par rejoindre une troupe de théâtre, abandonnant son nom et la ville de New York pour une forme d'anonymat bien américain, Bardamu, à la fin du Voyage, quitte Rancy et est embauché dans une troupe de cinéma, le “Tarapout”. Les deux personnages, profondément marqués par une étrangéité au monde et une difficulté ontologique à rencontrer l'autre, finissent leur aventure par un énième départ, départ vers un ailleurs vague et marqué par le masque, le jeu. Pour celui qui peine à rencontrer l'autre, il n’y a plus qu'une seule issue : devenir autre.
Littérairement vôtre,
Ève
Marie-Claude Schapira, « George Sand et l’Amérique », in George Sand critique. Une autorité paradoxale, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2011.
L'Amérique au tournant. La place des États-Unis dans la littérature française (1890-1920), dir. F. Dubosson et P. Geinoz, Paris, Classiques Garnier, 2020.
F. Dubosson et P. Geinoz, Ibid.
F. Dubosson et P. Geinoz, Ibid.
F. Dubosson et P. Geinoz, Ibid.
= roman d’apprentissage.
J’utilise pour ce texte la traduction de Récits, romans, journaux dans la collection “La Pochothèque” du Livre de Poche.
Jacques Dugast, “L'écriture de la ville dans Amerika de Kafka”, in Littératures, 1989. (sur Persée)
Claudine Raboin, « L'Amérique, un souvenir d'enfance de Kafka », in Études germaniques, n°62, 2007. (sur Cairn)
Claire Marion Perrin, Le carnavalesque noir du portrait de l'Amérique chez Céline et Cendrars, Californie, 2015. (En ligne)
Claire Marion Perrin, Ibid.
Dante, Inferno, chant VI, trad. Félicité Robert de Lamennais. Flammarion, 1910.
Claire Marion Perrin, Op. cit.
F. Dubosson et P. Geinoz, Op. cit.